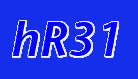 Association "Histoire de la Résistance de la
Haute-Garonne
Association "Histoire de la Résistance de la
Haute-Garonne
Livre "L'Esprit de Résistance", par Serge
Ravanel
|
|
|
|
|
"L'esprit de
Résistance", par Serge Ravanel (*) °°°° "Pourquoi la Résistance intérieure continue-t-elle de susciter une telle sympathie, une si grande curiosité ? Pourquoi de plus en plus d'individus considèrent-ils qu'elle pourrait servir de référence dans la dure situation que traverse le pays ?", écrit Serge Ravanel dans la préface du livre qu'il a publié en 1995, et qui s'intitule "L'esprit de Résistance" (1). Cet ouvrage passionnant, écrit par l'un des responsables nationaux de la Résistance, qui fut Colonel F.F.I. à l'âge de vingt-quatre ans, relate avec beaucoup d'objectivité et de rigueur historique ce qu'a été la Résistance intérieure, en particulier dans la région Midi-Pyrénées - puisque Serge Ravanel a été le dirigeant des forces militaires qui ont combattu avec succès pour la libération de la région de Toulouse -. C'est pourquoi nous vous proposons ici une note de lecture sur ce livre de référence : composé de cinq parties que nous résumerons successivement, plus des annexes et un index, ce livre complète heureusement l'importante bibliographie existant déjà sur la Résistance, car il s'agit des mémoires d'un homme d'action, et de l'un des principaux acteurs de cette période essentielle de l'Histoire. **** I. L'EFFONDREMENT La première partie relate l'adolescence de Serge Ravanel, "élève studieux du lycée Louis-le-Grand à Paris", et la manière dont il fut marqué par l'expérience personnelle de sa mère, qui avait participé au mouvement d'indépendance en Tchécoslovaquie, avant de décider de s'installer en France, pays qui "incarnait, à ses yeux, la Liberté, la Révolution de 1789, la République, les Droits de l'homme". Cependant, Serge Ravanel prit très tôt conscience des menaces qui planaient sur l'Europe puisqu'en septembre 1937, il séjourna à Vienne chez des amis juifs autrichiens qui lui firent part de leurs craintes envers le régime nazi ; ces amis durent d'ailleurs se réfugier en France en 1938, après l'annexion de l'Autriche, et firent partie des 1017 déportés juifs embarqués à Drancy le 6 septembre 1942 en direction d'Auschwitz, où ils trouvèrent la mort. En raison des voyages qu'il effectuait à cette époque en Europe centrale, Serge Ravanel avait ainsi compris la réalité et la gravité de la situation : "J'en savais beaucoup plus que mes camarades sur la situation à l'étranger. Je n'ignorais pas qui était Hitler. J'avais vu la morgue des policiers allemands qui circulaient dans les trains. La peur qu'ils inspiraient était visible. Les voyageurs jetaient des regards furtifs d'animaux pris au piège. Je découvris que la peur avait une odeur". En juin 1939, Serge Ravanel réussit le concours d'entrée à l'École Polytechnique ; fin août, il reçut un ordre de mobilisation qui l'affectait à cette Grande École et en mai 1940, à l'âge de vingt ans, il partait en qualité d'élève à l'école d'artillerie de Fontainebleau : il devait rejoindre le front avec le grade de sous-lieutenant au mois d'octobre. C'était cette période étrange où les Français baignaient dans une sorte d'euphorie, sans prendre conscience du désastre qui les attendait face à l'offensive de l'armée allemande : désastre brutal qui aboutit à l'armistice du 17 juin 1940 et à la nomination, par le président de la République, du Maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, pour constituer le Gouvernement. Certes, "le mardi 18 juin 1940, de Gaulle avait lancé, de Londres, son appel prémonitoire à la poursuite de la lutte" ; mais, "assommée, la France, dans son ensemble, était incapable de l'entendre". Serge Ravanel décrit l'atmosphère qui régnait au moment de l'application de cet armistice, la division de la France par une "ligne de démarcation" entre la "zone occupée" dans le Nord, et la "zone libre" dans le Sud ; il rappelle aussi que jusqu'au bout des troupes françaises continuèrent à se battre "sur la Loire, en Bretagne, dans les Alpes, sur la ligne Maginot. Souvent sans en avoir reçu l'ordre. De leur côté, nos aviateurs comme nos marins étaient loin de se considérer comme battus. Il y eut beaucoup d'héroïsme dans cette guerre. On oublie qu'elle coûta 90 000 morts, soit 2 000 par jour en moyenne". Pourtant, l'ambiance qui dominait lors des premiers mois de l'armistice était une sorte de soulagement aveugle, et d'incrédulité face à la brutalité de la défaite militaire. Serge Ravanel, qui s'était engagé dans les Chantiers de Jeunesse en voie de création, dont il croyait qu'ils constitueraient une force de réserve destinée à renforcer la petite armée d'armistice, au cas où on reprendrait le combat, faisait partie de ceux qui se posaient des questions, et ne croyaient pas à la réalité de ce désastre. En novembre 1940, les autorités militaires lui donnèrent l'ordre de rejoindre l'École Polytechnique, repliée à Lyon dans l'enceinte de l'École de santé militaire ; il put découvrir ce qu'était la vie quotidienne sous l'occupation, les fils, soldats de l'armée française, prisonniers en Allemagne, l'économie désorganisée, les tickets de rationnement, le manque d'essence et de papier pour les journaux... "Une impression de malheur domine. Pour une nation qui a pris l'habitude d'être tenue en haute estime dans le monde, subir une défaite aussi cinglante est terrible. Chacun se sent humilié. Honteux, même. Le doute s'est installé dans les esprits". C'est pourquoi, lors des premières années, si peu de Français pensèrent à rallier le Général de Gaulle ; pourtant, la Résistance commençait déjà à s'organiser ; et c'est la ville de Lyon qui "a été longtemps considérée comme la capitale de la Résistance en France". Certes, cette Résistance prit d'abord la forme d'actes individuels, comme à Rouen, Royan ou Épinal ; mais dès l'automne 1940, des groupes se constituèrent, comme le "réseau du Musée de l'Homme" à Paris, ou le futur mouvement de résistance en zone Sud, Libération, à Clermont-Ferrand. Ce "refus de la défaite", s'il était loin d'être majoritaire, était néanmoins une réalité dès les premiers mois de l'occupation nazie. II. RÉSISTER. COMMENT ? L'exemple de Serge Ravanel illustre les interrogations qui déjà se posaient à certains Français qui refusaient la défaite ; lui-même prépara son départ pour l'Angleterre, via une filière qui passait par l'Espagne et le Portugal, où la rumeur prétendait que l'Ambassade anglaise à Lisbonne accueillait les volontaires avant de les embarquer pour Londres. Mais en avril 1941, alors que l'Allemagne avait déclenché une nouvelle offensive contre la Grèce et la Yougoslavie, Serge Ravanel fit connaissance à Lyon du Général Cochet, qui diffusait des bulletins clandestins favorables aux Britanniques ; cet Officier supérieur de l'Armée de l'Air, membre de l'État-major de l'Armée, délivrait un message optimiste quant à l'issue du conflit ; certes, ses propos étaient mesurés en raison du contexte de l'occupation, mais il était évident qu'il était hostile aux Allemands. Grâce à lui, Serge Ravanel entra en relation régulière avec l'antenne lyonnaise du groupe de Résistance que ce général avait créé. Ce groupe se bornait à étudier la situation militaire, cherchant à y trouver les raisons de ne pas perdre l'espoir en la victoire. Ainsi, en 1941, des personnes comme Serge Ravanel s'étaient déjà engagées en faveur d'une perspective différente de celle d'une collaboration avec les nazis ; en outre, il apparaissait que les clauses du traité d'armistice signé par le Maréchal Pétain perdaient leur signification, car ce dernier ne cessait de céder aux exigences successives du pouvoir hitlérien, sous la forme d'un soutien actif à l'ennemi, d'une caution immorale à sa politique raciste et antisémite, et de la mise en place d'un régime politique autoritaire qui remettait en cause les valeurs républicaines et laïques de la société française. Ce climat poussa Serge Ravanel à vouloir en faire plus. Il devint alors membre d'un autre mouvement de résistance dont le siège, situé rue de Constantine à Lyon, réunissait des résistants de la première heure, des personnalités comme Hubert Beuve-Méry, futur fondateur du journal Le Monde, Jean Lacroix, André Frossard, le père Chaillet, Louis Terrenoire ou le pasteur de Pury ; Serge Ravanel commença ainsi l'action secrète, prenant un pseudonyme et organisant des groupes de diffusion de presse clandestine, diffusant plusieurs centaines d'exemplaires de journaux chaque semaine dans Lyon et sa banlieue. C'était à l'époque où l'Allemagne avait déclenché son offensive contre la Russie, et où le Japon était brutalement entré en guerre en détruisant la flotte américaine basée à Pearl Harbor. Par l'intermédiaire de son groupe d'action clandestine, Serge Ravanel fit connaissance de résistants du monde ouvrier, en particulier dans le milieu ferroviaire ; ce réseau commençait à mettre au point des sabotages pour gêner les trains qui partaient pour l'Allemagne ; de telles actions de sabotage existaient déjà dans plusieurs villes françaises, à Bordeaux, Marseille ou Paris, dans les usines Renault qui construisaient des blindés pour l'armée allemande. De plus en plus engagé, Serge Ravanel faillit adhérer au printemps 42 au mouvement de résistance d'obédience gaulliste Combat, qui s'étendait dans toute la zone Sud, car toutes les petites formations qui existaient cherchaient à se fédérer pour coordonner leur action ; mais les aléas de l'action clandestine ne permirent pas la mise en place de cette coopération ; par contre, au mois de juin, il rencontra un dirigeant du Mouvement de résistance "Libération", qui l'embaucha pour travailler au secrétariat de l'organisation. il était chargé de porter des courriers, de prendre certains contacts et éventuellement d'assurer des missions de protection. Il s'agissait d'actions clandestines, avec ses règles draconiennes et sa discipline permanente ; Serge Ravanel découvrit qu'il participait au mouvement Libération, l'une des quatre grandes formations de la Résistance en zone Sud (son journal clandestin était diffusé à plus de 100 000 exemplaires !), à côté desquels existaient de nombreux réseaux plus spécialisés dans le renseignement ou le passage des frontières. Ces mouvements acceptèrent de s'unir sous l'autorité du Général de Gaulle à partir de la fin de l'année 1941, grâce à l'action de Jean Moulin dont le rôle était de constituer l'Armée Secrète ; la situation et la répression en métropole rendaient ces actions difficiles et dangereuses, et il y avait parfois des frictions entre la Résistance intérieure et le Bureau Central de Renseignement et d'Action (BCRA) de l'état-major gaulliste installé à Londres- commandement central dont le rôle était d'organiser le parachutage d'agents radio et d'armes et l'envoi de fonds financiers -. Mais dans l'ensemble, la Résistance était une réalité combattante dès 1942. En Novembre 1942, Serge Ravanel partit pour Marseille, afin d'étudier avec les responsables locaux la mise en place de groupes de sabotage ; or, à la place du correspondant avec lequel il avait rendez-vous, il tomba sur un Policier, qui l'arrêta immédiatement ; conduit à "l'Évêché" - l'Hôtel de Police de Marseille -, Serge Ravanel s'attendait évidemment au pire ; mais il réalisa très vite que certains de ces Policiers étaient des résistants et qu'ils étaient prêts à faciliter son évasion -ce qu'il ne manqua pas de faire dès le lendemain de son arrestation ! - ; Serge Ravanel parvint alors à rejoindre Lyon. En novembre 1942 se situe le "tournant décisif" de la seconde guerre mondiale : afin de riposter au débarquement américain en Afrique du Nord, l'armée allemande occupa la zone libre, ce qui donna naturellement une autre dimension aux activités de la Résistance. A la suite de la dissolution de l'Armée française d'Armistice (ce qui entraîna notamment le sabordage dramatique de la flotte française à Toulon), l'Armée Secrète décida de récupérer certains des dépôts d'armes clandestins que l'Armée avait constitués après la défaite de 1940 : action difficiles à mener ; mais cette "période de novembre 1942 à mars 1943 marque un tournant pour la Résistance de zone sud ; c'est le début de la phase adulte ; celle de l'action et du combat" ; l'une des principales conséquences de cette phase fut l'unification continue des forces éparses de la Résistance intérieure dont une étape à été la fusion des MUR en mars 1943, et la création du Conseil National de la Résistance (CNR) le 27 mai 1943 par Jean Moulin. La défaite des Allemands à Stalingrad face à l'armée soviétique en février 1943, connue grâce à la radio de Londres, eut un impact très positif sur le moral et la crédibilité des forces de la Résistance française ; un autre fait, la création par le gouvernement de Vichy le 16 février 1943 du STO (service de travail obligatoire) poussa les jeunes français à s'engager dans la Résistance, par le biais des maquis que l'Armée Secrète commençait à implanter sur tout le territoire français. L'ampleur de ce succès ne doit pas cependant faire oublier les dangers de la vie quotidienne clandestine : en mars, de retour d'une mission à Chambéry, Serge Ravanel est arrêté, ainsi qu'une vingtaine de Résistants lyonnais - parmi lesquels Maurice Kriegel et Raymond Aubrac - ; un agent de liaison avait été interpellé quelques heures plus tôt par la Police française, qui avait trouvé sur lui des courriers de la Résistance ainsi qu'un agenda avec des adresses... Après avoir été interrogés, les prisonniers ont été incarcérés à la prison St-Paul sous l'autorité de l'administration pénitentiaire française. Cela n'empêcha pas quelques-uns d'entre eux de subir un interrogatoire de la Gestapo. À la suite de cet événement, la direction du Mouvement Libération décida d'organiser l'évasion de quelques-uns des prisonniers. Un commando de résistants procéda à leur enlèvement après qu'ils eurent réussi à se faire transférer à l'hôpital de l'Antiquaille pour cause de maladies simulées. Cette action contribua à crédibiliser et augmenter l'influence de la Résistance auprès de la population française : dans les esprits, la légitimité commençait à changer de camp. **** III. LE BON CHOIX : L'ACTION IMMÉDIATE Après son évasion, Serge Ravanel retrouva sa compagne Jeannette - une infirmière, soeur cadette de la femme d'un des dirigeants de Libération que d'Astier de la Vigerie avait convaincue de s'engager dans la Résistance -. Jeannette mit Serge Ravanel au courant des évolutions de l'organisation interne de la Résistance, en particulier la fusion de Libération avec Combat et Franc-Tireur au sein des MUR ; l'un des dirigeants, Pascal Copeau, proposa alors à Serge Ravanel de devenir l'adjoint d'un militant de Combat, Pierre, à la direction du Service national des groupes francs créés par les MUR ; cette structuration efficace, rendue nécessaire par la fusion des trois organisations - un responsable par région et par département - allait de pair avec la mise en place de ces groupes francs (GF), des "groupes d'action constitués d'hommes expérimentés. Ils auront à se livrer à des opérations, conformément à la politique de combat définie par la direction des MUR. Ces actions seront mises au point dans les régions avec les chefs locaux du mouvement. Votre direction nationale décidera des plus importantes. Vous aurez à faire des coups de main pour libérer des prisonniers, pour attaquer des dépôts de matériel ou d'armes. Il faudra réaliser des sabotages ou des déraillements de train et effectuer des actions contre des agents de l'ennemi" ; les GF devaient également s'en prendre aux troupes allemandes, "lorsqu'elles s'opposent à la réalisation de vos objectifs. En revanche, nous ne sommes pas partisans d'actions ayant pour seul but de tuer. De nombreux camarades craignent que cela ne provoque des représailles contre la population. Notre point de vue sur ce problème évoluera sans doute". La mise en place des GF, au mois de juin 1943, se faisait dans un contexte militaire international particulier : les forces alliées avaient repris le dessus, mais la propagande nazie et vichyste continuait avec efficacité à faire croire à l'inéluctabilité de la victoire allemande, ce qui explique l'attentisme d'une bonne partie de la population française, et donne la mesure du réel courage de ceux qui étaient engagés dans la Résistance. Le samedi 12 juin 1943, Serge Ravanel se vit confier les fonctions de chef national des GF par la direction des MUR, avec un adjoint issu de Franc-Tireur et un autre de Combat. Ils se répartirent les six régions de la zone Sud de la France ; pour les régions de Toulouse et de Limoges fut désigné le responsable GF de Combat à Toulouse, Marcel Joyeux, dit Joly. Après la nomination de dirigeants nationaux et départementaux, l'objectif principal des GF était de passer à l'action militaire de façon coordonnée, en attendant le débarquement des forces alliées. La tâche des GF était difficile, et Serge Ravanel cite l'exemple de l'arrestation d'un traître qui travaillait pour la Gestapo : "les GF devaient veiller à ne pas commettre d'actes susceptibles de ternir la réputation de la Résistance" ; un autre événement de cette époque, beaucoup plus dramatique, fut l'arrestation à Caluire, le lundi 21 juin 1943, de Jean Moulin, président du Conseil National de la Résistance, et de plusieurs autres Résistants, dont Raymond Aubrac (qui faisait suite à l'interpellation du Général Delestraint, le 9 juin à Paris) ; sauvagement torturé par Klaus Barbie, Jean Moulin mourut des suites de ses blessures dans le train qui l'emmenait vers Berlin, au quartier général de la Gestapo en Allemagne. La Résistance s'employa alors à préparer l'évasion de Raymond Aubrac, qui fut réussie quelques mois plus tard par l'action d'un groupe-franc de Ravanel, qui attaqua le fourgon dans lequel il était transporté avec treize autres détenus. Mais tout ceci démontre les grandes difficultés et les risques encourus par les Résistants dans la mise en place des structures nécessaires à la Libération de la France. Malgré les coups portés, les GF des MUR connurent un développement rapide dans toutes les régions françaises, et parvinrent à mener de nombreuses actions de sabotage (transformateurs dans les usines lyonnaises travaillant pour les Allemands, chemins de fer, pylônes électriques, dépôts de munitions à Grenoble, etc.) ; ils arrivèrent aussi à faire évader plusieurs Résistants incarcérés, comme Raymond Aubrac, le 21 octobre 1943 ; psychologiquement, la réussite de cette évasion fut très importante pour la crédibilité de la Résistance intérieure, et le 23 octobre la radio de Londres évoqua cette "grande opération qui témoignait de la maturité à laquelle était parvenue la Résistance". Le Conseil National de la Résistance (CNR) de Jean Moulin - dont l'objectif était d'unifier les différents mouvements résistants sous l'autorité du Général de Gaulle - s'était établi à Paris ; Serge Ravanel décida donc de s'y rendre et d'y transférer la direction nationale des GF ; la Résistance fit un nouveau pas dans le sens de l'unité, les MUR devenant le MLN (Mouvement de Libération Nationale), qui regroupait toutes les organisations existant en métropole. Dans le même temps, les GF continuaient leurs actions, comme par exemple en août 1943 à Toulouse où un dépôt de 24 camions militaires allemands fut détruit et un local de la Feldgendarmerie attaqué à la grenade. Des actions plus originales furent également menées, comme l'impression et la diffusion de 25 000 exemplaires d'un pastiche d'un grand quotidien collaborateur lyonnais, le Nouvelliste. Ainsi, malgré la répression qui restait féroce, la Résistance était en mesure de mener des opérations spectaculaires, qui avaient un fort impact sur la population. Un élément déterminant de cette période dont Serge Ravanel eut connaissance fut la sinistre opération "Vent printanier" : des centaines de policiers français furent mobilisés en juillet 1942 pour arrêter 27 000 Juifs et les livrer aux Allemands afin de les exterminer : 12 884 personnes (dont 4051 enfants) furent rassemblés au Vel d'Hiv, puis déportés à Auschwitz ; trente seulement survécurent à cette rafle monstrueuse, qui posa la question de la nature réelle des camps de concentration : ils étaient en réalité des camps d'extermination, des camps de la mort ; les gens le savaient depuis l'automne 1942, grâce à différents témoignages, même s'il fallut attendre la fin de la guerre pour prendre la mesure totale de la barbarie qui avait assassiné plusieurs millions de personnes. Au cours de l'été 1943, la Résistance réorganisée se partageait entre les partisans de "l'action immédiate" et ceux du "Jour J" (c'est-à-dire le jour du futur débarquement des forces alliées, le 6 juin 1944, en Normandie) ; outre les divergences tactiques, se posait le problème du manque d'armes, malgré les parachutages effectués par le commandement de la Résistance installé à Londres. Serge Ravanel, pour sa part, était favorable à l'action immédiate, via la tactique de la guérilla, ce que faisaient par exemple les FTP proches du Parti communiste ; mais cette tactique risquait d'entraîner des représailles sur la population. D'autres groupes se montraient eux, plus favorables à l'implantation de maquis peu actifs, vivant dans l'attente de l'offensive alliée. Un véritable débat s'était ainsi instauré dans la Résistance : "Pour ou contre l'action immédiate". À la fin de 1943 le CNR avait tranché ; il ordonnait de développer la guérilla. C'est aussi à la fin de 1943 que Serge Ravanel entra en relation avec des hommes du Special Operations Executive (S.O.E.), organisme anglais chargé de mener des actions contre les forces allemandes dans les territoires occupés ; la section française, le S.O.E.F., était dirigée par le Colonel Maurice Buckmaster, l'un des directeurs de la société Ford à Paris avant la guerre ; les deux frères d'André Malraux, Roland et Claude, appartenaient au S.O.E.F., et André Malraux lui-même, que Serge Ravanel rencontra à Brive (Corrèze) en novembre 1943 au nom du CNR, semblait préférer être en liaison directe avec les services britanniques - conséquence logique des règles de cloisonnement de l'action clandestine -. Le résultat probant de cette effervescence fut qu'à la fin de l'année 1943 la Résistance unifiée (patriotes de droite, militaires, gaullistes, socialistes et communistes) parvint à tisser des liens de plus en plus forts avec la population française ; une autre conséquence a été l'apparition d'une perspective pour l'après-guerre, la constitution de ce que Serge Ravanel appelle "L'Esprit de Résistance" : un ensemble de valeurs communes pour la reconstruction de la République Française. Cependant, le temps de l'action n'était pas achevé, celui de la répression non plus : par exemple, en février 1944 à Lyon, des miliciens arrêtèrent et firent fusiller plusieurs Résistants ; les responsables de Toulouse, Marcel Joyeux, et de Montpellier, Louis Torcatis, furent assassinés ; en tout, une centaine de militants et dirigeants des GF ont été tués ou sont morts en déportation. D'autres groupes, comme la MOI (Main-d'Oeuvre Immigrée), dont dépendaient le fameux groupe Manouchian - célébré par le poème de Louis Aragon - et la brigade Langer - dont le chef, Marcel Langer, fut guillotiné à Toulouse le 23 juillet 1943 -, payèrent également un lourd tribut à la libération de la France. En mars-avril 1944, les dirigeants Mouvement de Libération Nationale (MLN) se réunirent à Paris, rue des Beaux-Arts, ainsi que le dirigeant de l'Armée Secrète (AS), Malleret le chef national des maquis, Georges Rebattet, le responsable de L'Action Ouvrière Kriegel, et le chef des GF, Serge Ravanel ; il s'agissait de mettre au point le rapprochement avec l'AS, avec la création des CFL, les Corps Francs de la Libération. Serge Ravanel fut désigné comme responsable du bureau Action (3ème bureau) de l'état-major national de CFL, et plus particulièrement chargé de la formation des CFL à Toulouse. Serge Ravanel prit donc le train pour Toulouse, le vendredi 7 avril 1944. Il trouva une ville en état de choc, car elle ventait de subir un bombardement de l'aviation alliée sur diverses usines d'aviation qui avait fait des victimes civiles ; en outre, il put constater que les mouvement locaux de l Résistance n'étaient pars encore suffisamment unis; ce fut pourquoi, de retour à Paris, il se vit confier par l'état-major national des CFL le commandement de la région toulousaine, avec pour objectifs de réaliser la fusion des organisations et de développer l'action. Dans un premier temps, Serge Ravanel s'employa à établir des contacts avec le BCRA de Londres pour obtenir davantage de parachutages d'armes en faveur des maquis ; puis après s'être fait reconnaître par les différentes responsables régionaux, il mit au point plusieurs actions, comme le sabotage de la poudrerie de Toulouse. Mais la prolongation nécessaire de cette action militaire clandestine vit d'une façon simultanée la préparation de structures officielles, sous l'égide dur programme du CNR : élaboré par les dirigeants de la Résistance, il traduisait les aspirations de la population française, qui s'était ralliée massivement, concrètement, cela se traduisit localement par la nomination de Jean Cassou comme Commissaire de la République pour la région toulousaine, qui était chargé de mettre en place la nouvelle Administration après la Libération; au plan nationale le CNR créa un commandement unique des formations militaires, les FFI (Forces Françaises de l'Intérieur), à la fois dans un souci d'efficacité, et aussi pour permettre au Général de Gaulle, symbole de la Résistance Française d'éviter que les alliés anglais et américains ne placent les territoires prochainement libérés sous le contrôle de leurs propres autorités militaires ; organisation parachevée le 3 juin 1944 lorsque le Général de Gaulle transforma le Comité Français de Libération Nationale (CFLN) en Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF). IV. LIBÉRATION DE LA RÉGION DE TOULOUSE Tout était donc en place pour le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, préparé localement par différents messages diffusés par la BBC (exécution du plan vert- sabotages sur le chemins de fer-, du plan violet - sabotages des lignes téléphoniques-). Dès que le débarquement fut devenu une réalité militaire, Serge Ravanel et les autres dirigeants régionaux de la Résistance comme Jean Cassou prirent des disposition pour intensifier l'action contre l'occupant nazi ; d'autant plus que les armées allemandes du sud de la France réagirent avec férocité à l'arrivée des forces alliées sur le continent européen en menant des actions meurtrières contre des maquis ou la population civile, comme à Tulle le 9 juin (99 civils pendus et 311 arrêtés, dont la moitié seront déportés), ou à Oradour-sur-Glane, le 10 juin, quand les SS incendièrent le village : 642 habitants furent tués, dont 440 brûlés vifs dans l'église. Les maquis tentèrent d'harceler ces forces allemandes qui voulaient rejoindre la Normandie ; ils y parvinrent partiellement, mais subirent de lourdes pertes. L'accélération des événements entraîna la nomination de Serge Ravanel au commandement des forces FFI de la région toulousaine, avec le grade de Colonel et le nom de code "Hexagone" ; à ce titre, il coordonnait l'action de toutes les forces militaires de la Résistance. À cet effet, il noua des liens avec les différentes formations locales, comme les "groupes Vény" du Colonel Vincent dans le Lot, le Tarn, le Tarn et Garonne et le Lot et Garonne, le bataillon gersois de l'Armagnac de Claude Parisot, le Corps Franc de la Montagne Noire, le Corps Franc Pommiès (CFP) et les FTP communistes ; Serge Ravanel réussit à monter cette difficile unification des organisations aux objectifs communs, mais à la composition sociologique et politique différente ; il marque également sa reconnaissance aux "Espagnols pour avoir participé à la Résistance, ainsi qu'aux autres étrangers présents à Toulouse solidaires de notre lutte : italiens antifascistes, Yougoslaves, Roumains, juifs étrangers de la 35e brigade Marcel Langer. Nous avons eu des Allemands antihitlériens dans quelques-uns de nos maquis". Malgré le manque d'armes et le dispositif d'occupation allemand qui restait encore puissant au mois d'août 1944, les différents maquis de la région Midi-Pyrénées lancèrent de multiples opérations, souvent sous la forme d'embuscades qui contribuèrent grandement à déstabiliser l'ennemi et à compléter l'action des forces alliées en Normandie. Serge Ravanel décrit plusieurs de ces opérations menées avec brio et avec des moyens limités. À Toulouse, par exemple, de nombreux sabotages furent réalisés contre les usines d'aviation, en particulier à l'usine Latécoère où les Allemands étudiaient la mise au point d'un bombardier sans pilote, Météor, destiné à atteindre les États-Unis ; dans les usines de St-Martin du Touch, furent sabotées les hélices de Dewoitine ou le train d'atterrissage d'un Junker... la multiplication de ces actions de harcèlement gênait considérablement l'occupant, en attendant l'insurrection de la Libération ; mais le contexte restait dangereux : "jusqu'aux dernières heures de l'Occupation, on arrêtera donc et on fusillera. Les frères Lion, imprimeurs de journaux clandestins, furent arrêtés. Jacques Guillemin-Tarayre, rédacteur en chef du journal du MLN La République, tombé entre les mains de la Milice, sera exécuté le vendredi 18 août, la veille même de la Libération". Malgré la répression, Serge Ravanel put constater dans la région Midi-Pyrénées un climat favorable à l'épanouissement de la Résistance, où l'on "trouvait toutes les couches sociales, toutes les tendances politiques, toutes les confessions" ; ce fut tout d'abord la fameuse lettre pastorale de l'archevêque de Toulouse, Mgr Saliège, écrite en août 1942 lorsque les autorités françaises organisèrent en zone Sud des rafles contre les Juifs : "dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et du Récébédou. Les Juifs sont des hommes ; les Juives sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères". Plusieurs autres ecclésiastiques, comme les évêques de Montauban et d'Albi ou le recteur de l'Université catholique de Toulouse, soutinrent la Résistance, de même que de nombreux prêtres. Plusieurs aristocrates s'engagèrent, de même que des officiers de carrière, au sein de réseaux performants comme le corps franc Pommiès, le réseau Morhange, le Mouvement Libérer-et-Fédérer, le réseau Françoise, les groupes Vény, le ralliement massif de la franc-maçonnerie, le groupe des Éclaireurs israélites du maquis de Vabre dans le Tarn, les républicains espagnols, la 35e brigade MOI, etc., tout un ensemble de forces qui surent se rassembler et créer une Résistance offensive et unie. Ce fut à Carmaux, dans le Tarn, que se déclencha le premier acte d'insurrection dans la région, le mercredi 16 août ; grâce à un système d'agents de liaison, la Résistance était bien organisée et put coordonner efficacement toutes les actions des groupes FFI dans les divers départements de la région ; tout se passa très vite puisque le 19 août, Toulouse était libérée, et que les soldats allemands se repliaient précipitamment ; partout, dans leur déroute, ils se heurtèrent aux attaques des maquis, avec parfois des combats très durs, comme dans le Tarn ou l'Ariège. Mais alors que les FFI continuaient à se battre avec le soutien de la population, les dirigeants locaux de la Résistance civile, sous la direction du Commissaire de la République Jean Cassou, s'employaient déjà à "restaurer la République" et mettre en place dans les meilleurs délais les nouvelles autorités ; un grave incident démontre la fragilité de la situation : Jean Cassou, l'homme clef de cette réorganisation administrative et politique, fut grièvement blessé à la suite d'un accrochage avec une colonne allemande qui tentait de traverser Toulouse. Il fut remplacé par Pierre Bertaux à la tête de la nouvelle Administration. Le 21 août fut organisée une grande manifestation, place du Capitole, qui rassembla trente à quarante mille personnes ; "le Commissaire de la République, le Maire de Toulouse, Marcouire, un de nos camarades tout juste libéré de la prison St-Michel, et moi-même prîmes la parole du haut du balcon de l'Hôtel de Ville" : il s'agissait de mobiliser les Toulousains, renforcer la protection de la ville et soutenir les FFI qui continuaient à se battre ; car la guerre n'était pas terminée. V. APRÈS LA LIBÉRATION L'Armée de la Résistance qui avait mené ces combats courageux dans la région toulousaine (ils y firent plus de 1000 morts et 13000 prisonniers) était hétéroclite : "des pauvres, voilà bien ce que nous étions. Certainement pas une armée au sens traditionnel. Notre capital ? Du courage, la volonté de se battre, des cadres dont certains possédaient des talents exceptionnels. Et aussi un sens élevé du devoir civique. Il fallait donner à cette armée qui émergeait de la clandestinité une instruction, former ses officiers, oeuvrer pour l'unité entre officiers de carrière et officiers d'origine FFI". Cette homogénéisation des forces de la Résistance fut difficile à réaliser, et c'est l'un des principaux regrets exprimés par le chef militaire que fut Serge Ravanel. Le bilan était cependant largement positif, et surtout l'action des FFI se prolongea avec succès, puisque les troupes issus de la région toulousaine (environ 60 000 combattants) menèrent plusieurs batailles, soit dans la région comme l'action du bataillon de Parisot à L'Isle-Jourdain le 20 août, l'épopée de la colonne Soulé vers Bordeaux, Angoulême et Jonzac, ou bien la participation de 8900 Toulousains au "Groupement du Sud-Ouest et du Centre du Colonel Schneider" en septembre. Serge Ravanel démontre ainsi "l'éminente contribution de la Résistance à la victoire", fait capital aux conséquences très importantes pour la reconstruction et l'indépendance de la France après la guerre ; l'efficacité des FFI, reconnue par les Alliés, non seulement gêna considérablement l'armée allemande, mais fut le catalyseur de ce que Serge Ravanel nomme "l'esprit de Résistance", et qui fut le socle de la reconstitution morale des Français après des années d'occupation et de collaboration : l'esprit de résistance ne fut pas seulement un fait militaire, il allait contribuer puissamment à construire l'avenir immédiat. Serge Ravanel termine son ouvrage par la description de la réorganisation, rapide et solide, de l'appareil administratif, politique et économique de la région toulousaine, par l'intermédiaire des CLL (Comités Locaux de Libération), et enfin la venue du Général de Gaulle à Toulouse, les 16 et 17 septembre 1944 ; ce fut d'ailleurs l'occasion d'un autre des rares regrets de Serge Ravanel sur cette époque : la volonté centralisatrice du nouveau pouvoir gaulliste, au détriment des forces régionales qui s'étaient exprimées à travers la Résistance. En conclusion, Serge Ravanel évoque à nouveau cet Esprit de Résistance qui permit de vaincre le nazisme et ses collaborateurs vichystes ; il exprime aussi l'espoir et la conviction que les valeurs issues de cette Résistance gardent toute leur force et leur actualité : outre l'intérêt historique évident d'un tel livre, les propos de Serge Ravanel ont l'immense avantage d'offrir d'excellentes réponses à des questions contemporaines. **** ___________________________________________________________________________________________________ (*) : par Maryse Turbé et Pierre Léoutre. (1) : Serge Ravanel (avec la collaboration de Jean-Claude Raspiengeas), "L'ESPRIT DE RÉSISTANCE", Éditions du Seuil, Paris, 1995, 444 p. |
L'association hR31 | Livre
en ligne | Lexique | Calendriers
| Revue de presse | Liens
| Email |
Reproduction interdite sans autorisation de l'association HR31 - Pour tout problème de consultation, écrivez au webmestre
Association
"Histoire de la Résistance de la Haute-Garonne",
chez M.
Pierre Léoutre,
15 rue
Jules de Sardac 32700 Lectoure, FRANCE
Mise à jour
: 16 mai 2020
Site hébergé par Free

